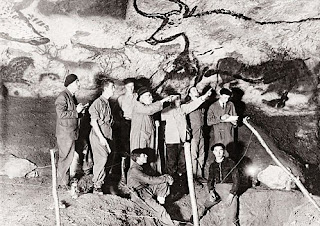|
| Walker Evans, Penny picture displays, 1936 |
American photographs
peut être perçu comme un livre qui ne traite pas d'un sujet prédéfini,
mais qui organise un matériau, une collection d'images. Walker Evans
devient le modèle même de l'artiste collectionneur et c'est ainsi qu'il
se qualifie : « Les
artistes sont, je crois, de manière figurée des collectionneurs. J'ai
déjà signalé que mon œil collectionne. Tout bon collectionneur le fait.
L'homme qui s'intéresse aux premières éditions françaises du
dix-neuvième siècle se fixe sur ça et y revient constamment par
instinct. Mon œil s'intéresse aux rues ou il n'y a que des rangées de
maisons en bois. Je les trouve et je le photographie. Je les
collectionne » 8
La
révélation publique de sa collection personnelle de plus de 9000 cartes
postales – aujourd'hui conservées au MoMA – qu'il avait entreprise à
l'âge de douze ans et poursuivie jusqu'à sa mort, confirme chez lui ce
goût de la collection et de l'agencement. En effet, il est amusant de
constater qu'il organisera ses cartes postales en séries typologiques :
« gares », « hôtels », « gratte-ciels », « trains »..., la plus fournie
étant celle des scènes de rue. Cette approche typologique est peut-être à
mettre en lien avec sa découverte du travail d'August Sander, mais
également celui d'Eugène Atget, qui agença aussi son œuvre de la sorte.
Imprégné de ces cartes postales, il réalisera même à plusieurs reprises,
des clichés similaires à celles-ci et ira jusqu'à recadrer une
vingtaine de tirages aux dimensions carte postale, en 1936. Cette
inclination à l'accumulation et à la collection se ressent encore dans
la production documentaire des cinquante dernières années, comme dans
les travaux de Berd et Hilla Becher et ceux des élèves de l'école de
Düsseldorf.
 |
| Anonyme, Morgan city, 1929/ Walker Evans, Street scene, 1935 |
La même année que la parution de son livre, une exposition rétrospective fut
proposée à Walker Evans. C'est Beaumont Newhall, directeur du
département photographique du MoMA, qui est chargé de son organisation.
L'exposition dura deux mois (du 28 septembre au 18 novembre 1938) et
comportait cent images. Au bout d'une semaine, Walker Evans bouscula
l'accrochage initial de Beaumont Newhall, et demanda qu'on le laissât
réaliser sa propre installation. En une nuit l'exposition est remontée.
Walker Evans a effectué des opérations de collages, mais aussi de
recadrages, à grands coups de ciseaux. Selon son système, du négatif au
tirage, une image pouvait être (re)taillée selon les besoins du cadrage.
Ce nouveau parti-pris de liberté désacralisait le tirage. Il bouscula
également le côté solennel des accrochages de l'époque en proposant
trois présentations différentes : des images sous passe-partout et
verre, sans verre, parfois sans l'un ni l'autre. L'exposition qui
précède le livre, offre une complexité différente de celui-ci : là où
elle procède par constellations (architectures, signes, bâtiments, gens, paysages)
qu'elle cumule, le livre lui se construit sur un jeu de correspondances
et de rythmes entre les images. Par ailleurs, la sélection des
photographies n'est pas identique aux deux : seules cinquante-trois
d'entre elles, présentées lors de l'exposition, se retrouvent dans le
livre. N'y figurent pas les images prises en Alabama en 1936, dialoguent
avec le texte de James Agee dans Let Us Now Praise Famous Men.
Le livre, éponyme de l'exposition, publié peu après l'événement, dépasse largement la fonction de catalogue d'exposition, il n'est pas le dernier témoignage
que l'on en a gardé après le démontage, ni un listing comptable des
photographies montrées au MoMA. Intégralement conçu par Walker Evans qui
impose format, sobre typographie, impression en noir et blanc, mise en
page binaire (page de gauche blanche, image en vis-à-vis à droite),
disposition des légendes en forme d'index, American Photographs
est probablement « le premier livre moderne de la photographie, auquel
tous les autres se sont mesurés. » Pour la première fois, un photographe
maîtrise entièrement l'espace créatif de son livre, qu'il complète ici
du texte de Lincoln Kirstein. American photographs
demeure l'oeuvre majeure de Walker Evans qu'il à mené seul de bout en
bout, véritable construction de sa pensée, miroir de sa vision du monde,
de son Amérique...
« Evans
est un grand faiseur d'images (picture maker), il est aussi un
narrateur (storyteller) qui, avant de se consacrer à la photographie, a
rêvé de littérature et de cinéma. Photographe, il collectionne des
amorces de récit. Narrateur, il condense du temps dans des images.
Chaque image est à la fois pièce et fragment ; un morceau (a piece) qui
fait un tout, tel un poème, mais qui peut être traité aussi en élément
de montage, placé dans un enchaînement narratif »9
 |
| Walker Evans, reconstitution de l'accrochage de l'exposition American photographs, 1938 |
8 CHEVRIER Jean-François, Walker Evans dans le temps et dans l'histoire, L'Arachnéen, Paris, 2010, p.52
9 Ibid., p.48