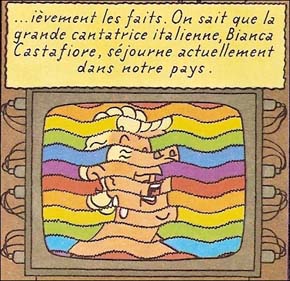A.S. : J'ai choisi, pour poursuivre cette étude subjective de la bande dessinée et de son histoire, de retenir cinq auteurs majeurs de la production française de ces 20 dernières années, de présenter leur parcours, et de prélever au sein de leur bibliographie une œuvre significative que je tâcherai de présenter un peu plus en détail. Aujourd'hui : Mattt Konture.
Mattt
Konture, l'Underground à la française.
-
Le rapport au médium : Né en 1965, Mattt Konture est un auteur peu
connu et pourtant essentiel dans le champ de la bande dessinée
française, et ce à plusieurs titres. D'abord, parce qu'il
est le représentant emblématique de la bande dessinée underground
d'expression française. J'entends par là que son rapport au médium
est déterminé par ce que nous sommes en droit de considérer comme
un cadre de pensée précis (le courant underground),
dont l'acception culturelle est apparue dans les années 50, puis
s'est affirmée aux États-Unis dans les années 60/70.
Ses principales caractéristiques sont la dimension
expérimentale, le rejet
concerté des courants culturels dominants,
et le développement d'un système de diffusion
indépendant des circuits commerciaux ordinaires. Le support
privilégié de ce système de pensée est en bande dessinée le
fanzine,
journal libre sans existence officielle, né de la passion et de la
conviction d'un amateur pas nécessairement éclairé, et publié
autant que diffusé de manière assez aléatoire. C'est donc dans ce
type de support que Mattt
Konture vient
à la bande dessinée, lui qui se revendique de la contre-culture
punk. Toutefois, la singularité (et la virtuosité) de son
esthétique confèrent à ses travaux une dimension artistique
nettement supérieure à la norme du fanzinat. Il participe aux revues Viper,
Nerf,
mais surtout au
Lynx à tifs,
où il fait la rencontre de J-C.Menu, en compagnie duquel (et de
quelques autres : Killofer, Trondheim, David B., Stanislas, Mokeït)
il s'apprête à bouleverser le paysage éditorial (et donc le
paysage tout court) de la bande dessinée française.
- L'Association
(à la pulpe):
descendant en droite ligne du Lynx,
via les revues AANAL
et Labo,
cette structure éditoriale est fondée en mai 1990, sur le modèle
juridique (comme son nom l'indique) d'une association Loi 1901. Sa
formation résulte de la volonté affichée de ses fondateurs de
poursuivre leurs ambitions esthétiques dans un nouveau cadre de
diffusion, abandonnant la distribution clandestine sous le manteau,
pour se lancer dans le grand concert de l'Édition. L'Association (à la pulpe) - puis très vite L'Association tout court,
se caractérise d'emblée par des choix éditoriaux qui confinent au
politique : maquettes soignées, collections nombreuses mais
homogènes, grande variété de format, publication de jeunes auteurs
(Sfar) en même temps qu'exhumations patrimoniales (Schlingo), noir
et blanc de rigueur, matériaux de grande qualité, autant d'éléments
qui ont fait de leur catalogue l'un des plus exigeants et des plus
prestigieux du monde de la bd. L'Association
a su montrer depuis plus de vingt ans (et malgré les récents ''remous''),
que l'on pouvait, à force de compétence et de conviction, concilier
exigences artistiques et impératifs économiques. Et au sein de
cette structure qui se distingue par la radicalité de ses choix,
Mattt
Konture
est peut-être l'un des auteurs les plus radicaux, avec J-C Menu et
quelques autres. Sa production est toujours restée fidèle à ses
premières amours, et s'est épanouie dans les collections les plus
''fanzinesques'' du label : ''Mimolette'',
''Patte de Mouche'' (c'est d'ailleurs lui qui inaugura cette
collection). Fondateur autant que fondamental, Mattt
Konture
est intimement lié au parcours de cette ''utopie esthétique et
éditoriale'' (ainsi que le dit le groupe ACME) qu'est l'Association,
montrant qu'en cette fin de siècle, la bande dessinée est prête à
accueillir, et surtout à reconnaître à la lumière du plein-jour,
ce qui jusque là s'était développé dans l'ombre de ses
souterrains.
 -
Corpus général : si l'on excepte l'auto-édition et les rares
''infidélités'' éditoriales (6 pieds sous terre), la
quasi-totalité du corpus de Mattt Konture est hébergée par
l'Association, ce qui, en un sens, n'est guère surprenant.
Toutefois, il faut prendre garde à ne pas réduire aux œuvres
effectivement publiées les dimensions d'un corpus que Pacôme
Thiellement n'hésite pas à qualifier ''d'illimité''. Mattt Konture
est un graphomane compulsif, qui ne cesse de dessiner et de noircir
depuis des années des pages et des pages de dessins,
d'illustrations, en vue (rare) ou non (moins rare) de publication.
Les imposantes Archives
parues récemment (2006) à l'Association sont en ce sens
suffisamment éloquentes, et ne peuvent que nous convaincre qu'il ne
s'agit là, malgré un effort de diffusion à souligner, que de la
partie émergée de l'iceberg. On ne doit donc pas tenter
d'appréhender le Grand œuvre de Mattt Konture dans sa dimension
quantitative (tâche d'Hercule probablement irréalisable,
certainement ridicule), mais bien qualitative; car depuis les
proto-fanzines des années 80 jusqu'aux publications les plus
récentes, Mattt Konture travaille sans cesse le même trait,
exprimant sensiblement les mêmes univers. Il explore de manière
systématique les ressources d'un n&b dont les hachures couvrent
la totalité des pages, ne laissant rien respirer, et creuse ainsi la
surface de la planche en une profondeur hypnotique. Ce trait
hallucinatoire (voire hallucinogène) organise l'œuvre-fleuve
de Mattt Konture en une façon de signature, et lui donne l'unité
que son ampleur lui refuse.
-
Corpus général : si l'on excepte l'auto-édition et les rares
''infidélités'' éditoriales (6 pieds sous terre), la
quasi-totalité du corpus de Mattt Konture est hébergée par
l'Association, ce qui, en un sens, n'est guère surprenant.
Toutefois, il faut prendre garde à ne pas réduire aux œuvres
effectivement publiées les dimensions d'un corpus que Pacôme
Thiellement n'hésite pas à qualifier ''d'illimité''. Mattt Konture
est un graphomane compulsif, qui ne cesse de dessiner et de noircir
depuis des années des pages et des pages de dessins,
d'illustrations, en vue (rare) ou non (moins rare) de publication.
Les imposantes Archives
parues récemment (2006) à l'Association sont en ce sens
suffisamment éloquentes, et ne peuvent que nous convaincre qu'il ne
s'agit là, malgré un effort de diffusion à souligner, que de la
partie émergée de l'iceberg. On ne doit donc pas tenter
d'appréhender le Grand œuvre de Mattt Konture dans sa dimension
quantitative (tâche d'Hercule probablement irréalisable,
certainement ridicule), mais bien qualitative; car depuis les
proto-fanzines des années 80 jusqu'aux publications les plus
récentes, Mattt Konture travaille sans cesse le même trait,
exprimant sensiblement les mêmes univers. Il explore de manière
systématique les ressources d'un n&b dont les hachures couvrent
la totalité des pages, ne laissant rien respirer, et creuse ainsi la
surface de la planche en une profondeur hypnotique. Ce trait
hallucinatoire (voire hallucinogène) organise l'œuvre-fleuve
de Mattt Konture en une façon de signature, et lui donne l'unité
que son ampleur lui refuse.
L'œuvre
: Krokrodile Comix I,
in Printemps,
Automnes,
L'Association, 1993
 -
Inscription dans le corpus général de l'auteur : le premier numéro
du fanzine Krokrodile
Comix est
d'abord paru en auto-publication, avant d'être réédité cinq ans
plus tard par l'Association, en une somme des travaux précurseurs de
l'auteur, Printemps,
Automnes.
Ainsi, il symbolise en même temps qu'il synthétise le parcours de
Mattt Konture : réminiscent de son passé fanzinesque, il s'inscrit
dans une collection établie de la toute récente association
éditoriale, et fait ainsi le lien entre les deux types de
production, soulignant du même coup les affinités qui existent entre l'Association et le fanzinat, symbole de la bande dessinée
contre-culturelle (mais pas contre-productive). C'est également dans
cet ouvrage que s'affirme un peu plus l'ambition qu'a l'auteur de
travailler le matériel autobiographique, pressenti comme point
d'origine de l'ensemble de son travail, sans que cela n'ait jamais
été explicité. Mattt Konture se lance donc avec son premier
Krokrodile dans
une entreprise autobiographique,
qui marque l'entrée de la bande dessinée dans un nouveau territoire
vertigineux : l'espace intérieur, qui n'aura de cesse d'être
exploré par les différents auteurs de l'Association, mais également
par l'ensemble de la bande dessinée contemporaine.
-
Inscription dans le corpus général de l'auteur : le premier numéro
du fanzine Krokrodile
Comix est
d'abord paru en auto-publication, avant d'être réédité cinq ans
plus tard par l'Association, en une somme des travaux précurseurs de
l'auteur, Printemps,
Automnes.
Ainsi, il symbolise en même temps qu'il synthétise le parcours de
Mattt Konture : réminiscent de son passé fanzinesque, il s'inscrit
dans une collection établie de la toute récente association
éditoriale, et fait ainsi le lien entre les deux types de
production, soulignant du même coup les affinités qui existent entre l'Association et le fanzinat, symbole de la bande dessinée
contre-culturelle (mais pas contre-productive). C'est également dans
cet ouvrage que s'affirme un peu plus l'ambition qu'a l'auteur de
travailler le matériel autobiographique, pressenti comme point
d'origine de l'ensemble de son travail, sans que cela n'ait jamais
été explicité. Mattt Konture se lance donc avec son premier
Krokrodile dans
une entreprise autobiographique,
qui marque l'entrée de la bande dessinée dans un nouveau territoire
vertigineux : l'espace intérieur, qui n'aura de cesse d'être
exploré par les différents auteurs de l'Association, mais également
par l'ensemble de la bande dessinée contemporaine.  -
Caractéristiques ontologiques : Krokrodile
comix,
on l'aura compris, est un livre de marge.
Et je vais tâcher d'expliquer ici en quoi ce principe
marginal se retrouve aussi sur un plan esthétique. La bande dessinée
se définissait jusqu'alors, d'un point de vue ontologique, selon
deux critères : art figuratif
et
narratif.
C'est précisément cette définition que Mattt Konture va
remettre en cause, faisant de l'infra-figuration
et de l'infra-narration
les deux piliers de son œuvre. Par ''infra-figuration'',
j'entends que son travail
procède d'une sorte de saturation graphique
: la planche est entièrement couverte de signes nerveux et
hypnotiques (traits, taches, points, lignes) qui la maculent, et la
rendent parfois illisible.
-
Caractéristiques ontologiques : Krokrodile
comix,
on l'aura compris, est un livre de marge.
Et je vais tâcher d'expliquer ici en quoi ce principe
marginal se retrouve aussi sur un plan esthétique. La bande dessinée
se définissait jusqu'alors, d'un point de vue ontologique, selon
deux critères : art figuratif
et
narratif.
C'est précisément cette définition que Mattt Konture va
remettre en cause, faisant de l'infra-figuration
et de l'infra-narration
les deux piliers de son œuvre. Par ''infra-figuration'',
j'entends que son travail
procède d'une sorte de saturation graphique
: la planche est entièrement couverte de signes nerveux et
hypnotiques (traits, taches, points, lignes) qui la maculent, et la
rendent parfois illisible. Mais cette saturation, si elle conteste l'ambition figurative du
dessin narratif, ne verse pas pour autant dans l'abstraction pure :
elle est plus au contraire l'expression d'une vision singulière, qui
hésite entre perception (dehors) et imagination (dedans). Le dessin
de Mattt
Konture oscille
en réalité entre figuration et abstraction, pour cerner au mieux
l'expérience intime vécue par l'auteur-regardant ;
le lecteur cesse alors de lire,
il devient spectateur et est convié à expérimenter ce que v(o)it
l'auteur. La bande dessinée, entre les mains de Mattt
Konture, se
dessine à la première personne. De la même manière, le
parti-pris narratif, qui était le socle inamovible sur lequel
s'était construite toute la bande dessinée jusqu'alors, vacille; le
récit n'est plus
l'unité structurelle de référence. Pourtant, Krokrodile
est
un livre extrêmement bavard ; à la saturation graphique évoquée
plus haut répond en effet une saturation textuelle du même ordre,
qui investit notamment le cadre des récitatifs, allant jusqu'à
emplir des cases entières (abolissant pour le coup toute figuration
graphique). C'est que le récit dans sa dissolution laisse le champ
libre au discours
: on passe d'un art de la narration
à
un art de l'énonciation,
le narrateur devient énonciateur. La question qui doit conduire
notre approche de l'œuvre n'est plus d'identifier ''de quoi
ça
parle ?'', mais bien de savoir ''qui
en elle
parle ?''. Par la remise en cause de la figuration et de la
narration, Mattt Konture modifie sensiblement le
fonctionnement de la bande dessinée, dont l'enjeu n'est plus de
raconter, mais de parvenir à
exprimer. Il est donc
l'un des premiers auteurs à faire du style
(dans toute la profondeur du terme) la pierre d'angle de son
esthétique.
Mais cette saturation, si elle conteste l'ambition figurative du
dessin narratif, ne verse pas pour autant dans l'abstraction pure :
elle est plus au contraire l'expression d'une vision singulière, qui
hésite entre perception (dehors) et imagination (dedans). Le dessin
de Mattt
Konture oscille
en réalité entre figuration et abstraction, pour cerner au mieux
l'expérience intime vécue par l'auteur-regardant ;
le lecteur cesse alors de lire,
il devient spectateur et est convié à expérimenter ce que v(o)it
l'auteur. La bande dessinée, entre les mains de Mattt
Konture, se
dessine à la première personne. De la même manière, le
parti-pris narratif, qui était le socle inamovible sur lequel
s'était construite toute la bande dessinée jusqu'alors, vacille; le
récit n'est plus
l'unité structurelle de référence. Pourtant, Krokrodile
est
un livre extrêmement bavard ; à la saturation graphique évoquée
plus haut répond en effet une saturation textuelle du même ordre,
qui investit notamment le cadre des récitatifs, allant jusqu'à
emplir des cases entières (abolissant pour le coup toute figuration
graphique). C'est que le récit dans sa dissolution laisse le champ
libre au discours
: on passe d'un art de la narration
à
un art de l'énonciation,
le narrateur devient énonciateur. La question qui doit conduire
notre approche de l'œuvre n'est plus d'identifier ''de quoi
ça
parle ?'', mais bien de savoir ''qui
en elle
parle ?''. Par la remise en cause de la figuration et de la
narration, Mattt Konture modifie sensiblement le
fonctionnement de la bande dessinée, dont l'enjeu n'est plus de
raconter, mais de parvenir à
exprimer. Il est donc
l'un des premiers auteurs à faire du style
(dans toute la profondeur du terme) la pierre d'angle de son
esthétique.
Nous
verrons bientôt, par la confrontation à Fabrice Neaud et à son
journal, comment des préoccupations globales similaires
ont pu conduire à l'édification d'une œuvre aussi dissemblable.