André Franquin, âge d'homme et phase terminale
*
Né en 1924, il reprend dans les pages de l'hebdomadaire Spirou les aventures du héros du même nom (1947), puis crée en 1957 le plus célèbre antihéros de la bande dessinée franco-belge en la personne de Gaston Lagaffe. Je me concentrerai ici sur son travail le plus tardif : les Idées noires, dont la position terminale (dans tous les sens du terme) interroge une œuvre immense en même temps qu'elle rend compte d'un tournant décisif de l'histoire de la bande dessinée.
*
Approche historique :
- Influences : à l'image de celle d'Hergé, l'œuvre de Franquin est d'une telle envergure (30 ans) que ses travaux les plus tardifs doivent être considérés à l'aune de ses travaux antérieurs. On notera simplement ici l'importance de l'inscription d'une œuvre dans un contexte de publication précis : celui des hebdomadaires illustrés pour la jeunesse, en l'occurrence le journal Spirou, de la maison Dupuis, alors en concurrence avec deux autres géants illustrés : Pilote (Dargaud), et Tintin. Ses plus grands succès se sont épanouis dans ce contexte précis, dont les principales caractéristiques sont : la publication en épisode (aménagement d'un suspens narratif), l'entreprise de divertissement (l'écrasante majorité des séries relèvent donc du genre comique ou d'aventure, ou bien des deux), et l'adresse à un public enfantin ou pré-adolescent. Ces trois dimensions (qui, ne l'oublions pas, datent de la fin du XIX° (Christophe)) déterminent largement la structure et les ambitions de la bande dessinée de la première moitié du XX° siècle (dite de ''l'âge d'or''), et ce jusqu'à la fin des années 60 (même s'il faut nuancer ce constat dans le cas de Pilote, dont la politique éditoriale assure une transition progressive entre publication enfantine et adulte) . Franquin n'échappe donc pas à la règle, même si le personnage de Gaston laisse progressivement entrevoir la possibilité d'une bande dessinée ''autre'', qui ne satisfasse pas à l'ensemble de ces trois critères, et notamment des deux derniers : l'ambition narrative, et le type de public visé.

*
- Innovations : Franquin est l'exemple type de l'auteur charnière, venu à la bande dessinée dans ce genre d'illustrés, et qui a progressivement permis l'épanouissement d'une autre forme d'existence pour le médium, plus mûre, plus sombre, moins consensuelle ou politiquement correcte : bref, qui aura participé au passage à l'âge adulte de la bande dessinée. En effet, les revues destinées à un public plus adulte se multiplient au courant des années 60 et 70 (Hara-kiri (60), Charlie Mensuel (69), L'écho des savanes (72), Métal Hurlant et Fluide Glacial (75), (A suivre) (78)), et les genres narratifs (SF (Druillet), Fantastique (Moebius), Histoire (Bourgeon, Tardi), satire politique (Gébé), érotisme (Varenne, Manara)) comme les styles graphiques (aquarelles, n&b) témoignent d'une volonté du médium d'explorer de nouveaux territoires). Dans cette effervescence, Franquin poursuit son entreprise esthétique et idéologique en en durcissant les traits principaux, et avance dès lors ''à visage découvert'' : son trait, comme le ton général de son œuvre, devient résolument sombre; il ouvre les vannes du noir. Il laisse libre court à la noirceur qui parcourait son œuvre ultérieure de façon sous-jacente, et sans se départir de sa verve comique ni de sa vivacité d'esprit, son humour bascule résolument du côté obscur. Ainsi, ses Idées Noires (au titre en ce sens suffisamment explicite, tout comme la couverture retenue pour l'intégrale chez Fluide, où l'on voie l'auteur littéralement « broyer du noir ») voient le jour dans un exemplaire ''pirate'' du journal Spirou (Le Trombone illustré, ''supplément clandestin''), dont la seule existence dit bien la volonté de certains auteurs « d'attaquer », de mettre en péril la forme fixe et convenue de la presse enfantine illustrée, alors hégémonique. Ces planches résistantes poursuivront leur dynamique contestataire dans les pages d'une nouvelle revue illustrée, qui confirme bien cette entrée du médium dans l'âge adulte : Fluide Glacial. Ainsi l'œuvre de Franquin, en mettant progressivement bas les masques, a bouleversé son fonctionnement interne, en même temps qu'elle a accompagné, sinon suscité, une véritable révolution médiatique, en terme de genre aussi bien que de support.
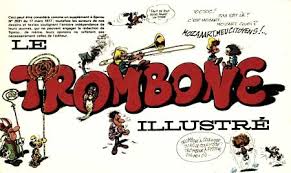
*
- Postérité : on vient de le voir, Franquin, par son parcours personnel (il est celui qui fut la figure centrale de l'hebdomadaire Spirou (créé en 1938), avant de contribuer au tout jeune Fluide), est emblématique d'une dynamique interne de diversification qui a secoué la bande dessinée entre les années 50 et les années 80. Il a, par sa production, accompagné le médium dans sa lente et longue mue. Il est intéressant de remarquer qu'il est cet auteur qui fit entrer de la manière la plus radicale le Noir sous toutes ses formes (si bien graphiques que thématiques) dans cet univers sans ombres (cf ''ligne claire'') qu'était la bande dessinée d'âge classique. Son apport est donc essentiellement symbolique : pour que la greffe prenne, il fallait qu'elle vinsse non d'une figure émergente et donc nécessairement marginale, mais bien d'une figure tutélaire et incontestable de ce qui s'appelait alors tout juste le 9°art. En ce sens, nous pourrions dire qu'il permit avec d'autres (Gotlib, Brétécher, Reiser), l'avènement d'une Nouvelle bande dessinée (comme il y eut un Nouveau roman et une Nouvelle vague), qui sans cette contribution minime (seulement 65 planches !) mais décisive (innombrables rééditions) serait restée dans l'ombre (dommageable) de l'anonymat.

*
Approche ontologique :
- Gestion du multicadre : Franquin a inventé le terme de ''gaufrier'' pour désigner un principe de mise en page dont il usa de manière fréquente quoique non-systématique, et que B. Peeters qualifie pour sa part de ''conventionnelle''. Ce dispositif particulier, par sa régularité et sa discrétion, tend à se faire oublier au moment de l'acte de lecture; le regard ''glisse'' sur lui. On retrouve ce principe d'organisation dans certaines planches des Idées Noires, et l'on peut voir dans cette volonté de se priver de certaines ressources plastiques de la bande dessinée une certaine influence cinématographique, médium contraint à l'immuabilité du cadre. La fixité du dispositif concentre donc l'attention du lecteur sur la moindre variation intervenant en son sein, cela ayant pour l'essentiel des effets surprenants sinon comiques; le gaufrier est ainsi l'un des moyens techniques privilégiés du gag à chute. La régularité de la mise en page permet donc de favoriser les figures de surgissement ou de contestation, les divers effets de surprise, que cela concerne la mise en séquence, ou la mise en image. Chaque rupture, dans cette disposition constante, verra son impact exhaussé du fait même de la constance du dispositif. Dans une mise en page rhétorique (Hergé) ou productrice (McCay), il est rare qu'une vignette se distingue vraiment des autres, dans la mesure où, en quelque sorte, chacune d'entre elles est singulière. Certaines planches des Idées Noires montrent bien en revanche à quel point le gaufrier permet ces phénomènes de mise en relief (cf p12, 23, 40, 59) d'une vignette particulière, située la plupart du temps en situation terminale. Mais Franquin dépasse cette dialectique constance/écart, en poussant le principe du gaufrier à son comble, et ce afin de renforcer certaines histoires mettant en scène l'idée d'enfermement, obsession récurrente de l'album (p41, 60). Le gaufrier devient alors, sur le plan structurel, la meilleure façon d'exprimer l'idée d'inéluctable, de répétition du même jusqu'à l'enfermement, et chacune de ces planches devient comme la structure métaphorique du labyrinthe sphérique mis en image dans l'album. Le gaufrier est un multicadre dont la répétition et l'invariance disent l'impossibilité qu'il existe à sortir de certains schémas, et donc, d'une certaine manière, le profond pessimisme de l'auteur lui-même, qui pense que « l'on ne s'en sortira jamais ».

*
- Écriture graphique : Franquin est l'un des chefs de file d'un style graphique dit « École de Marcinelle », fondée par le dessinateur Jijé, et dont les principales caractéristiques sont un goût prononcé pour le mouvement (cf formation dessin animé pour Franquin, Morris, Peyo), une grande attention portée aux détails – jusqu'à la saturation de certaines cases (on pense au bureau de Gaston ...), un trait foisonnant, une caractérisation bouffonne relevant de l'esthétique du ''groz-nez'', tous ces éléments ayant pour point de convergence une ambition assez globalement comique. Ces différents aspects font de l'école de Marcinelle le contrepoint absolu de l'école de Bruxelles, dont le chef de file était l'incontournable Hergé, si bien que l'on a pu désigner ce style graphique sous le vocable de ''ligne sombre'' (par opposition à ''ligne claire'' : astuce). Cette appellation trouve sa plus entière justification avec un album comme Idées Noires, où, du propre aveu de Franquin, l'on retrouve les personnages de Gaston mais comme « plongés dans de la suie ». La ligne est dès lors plus sombre que jamais. Et en effet, ne travaillant qu'au noir et blanc, Franquin donne ici à voir une sorte d'inquiétant théâtre d'ombres, où décors et personnages semblent tantôt gagnés par des sortes de ténèbres qui ont tout du mazout échappé des cales d'un navire (si bien que tout est comme englué, plongé rongé par cette marée noire), tantôt ensevelis par d'épais tapis de neige, ou soufflés par la déflagration aveugle et aveuglante d'un nuage atomique (on notera à ce propos la fréquence de motifs chromatiques tranchés : la neige et le mazout, donc, mais aussi l'espace intersidéral, les squelettes, les corbillards, les soutanes, les plumes, les taureaux et le sable blanc de l'arène ...). Les fragiles silhouettes tentent alors d'opposer une forme de résistance, en ombres chinoises, mais semblent toujours guettées par un total anéantissement, une disparition dans le blanc immaculé de la page ou dans le noir profond de l'encre de chine. Et cela donne lieu à des planches d'une beauté incroyable.

- Dynamiques narratives : Dominique Petitfaux a dit des Idées Noires : « Cette bande dessinée est peut-être la plus grande réussite d'André Franquin, qui y révèle sa vision de l'humanité et sa nature fondamentalement angoissée ». Nous l'avons vu, la bande dessinée à cette époque atteint l'âge d'homme. Elle abandonne alors ses seules prétentions de divertissement à destination d'un public enfantin, et Franquin ne se gêne pas pour y clamer haut et fort ce qu'il sous-entendait déjà dans les volumes plus tardifs de Gaston : son dégoût de toute forme d'autorité et de violence, son mépris du fanatisme religieux et du militarisme, son aversion pour le système d'exploitation capitaliste, le ridicule de la société de consommation, et son pessimisme quant aux possibilités restant à l'homme de sortir de tout ça. Les Idées Noires sont en ce sens explicitement politiques (Franquin y prend à de nombreuses reprises position contre la peine de mort, non encore abolie en France), dans le sens le plus incorrect du terme. On y découvre un auteur profondément angoissé, et qui ne cherche plus à dissimuler ses angoisses, bien au contraire : il y a quelque chose de pourri au royaume de la bande dessinée, il y a quelque chose de pourri dans le monde qui nous entoure, et les Idées Noires sont là pour nous le rappeler. Il est d'ailleurs très intéressant de remarquer qu'Hergé avait, au moment de sa grande dépression, produit un album immaculé : Tintin au Tibet. Les deux monstres sacrés de la bande dessinée franco-belge étaient donc également dépressifs, et l'expression de cette état s'est traduit chez l'un par un album résolument Noir, et chez l'autre par un album résolument Blanc. L'étude comparative de ces deux œuvres reste à faire, et serait, très probablement, des plus intéressantes.

*
C'est donc sur cette touche d'optimisme que j'achèverai le premier volet de mon étude subjective de la bande dessinée et de son histoire. Nous laissons le médium en proie à une grande effervescence ; l'exploration de nouveaux champs d'expression, ainsi que « l'érosion progressive des frontières » vont se poursuivre, et même s'intensifier. Les grands précurseurs, dont Franquin fait partie, ont semé ce que ne tarderons pas à récolter, à la fin des années 80, une génération de continuateurs (Menu, Trondheim, Killofer, Konture), qui contribueront par leurs différentes recherches à asseoir toujours un peu plus la légitimité d'un art en perpétuelle mutation.
































