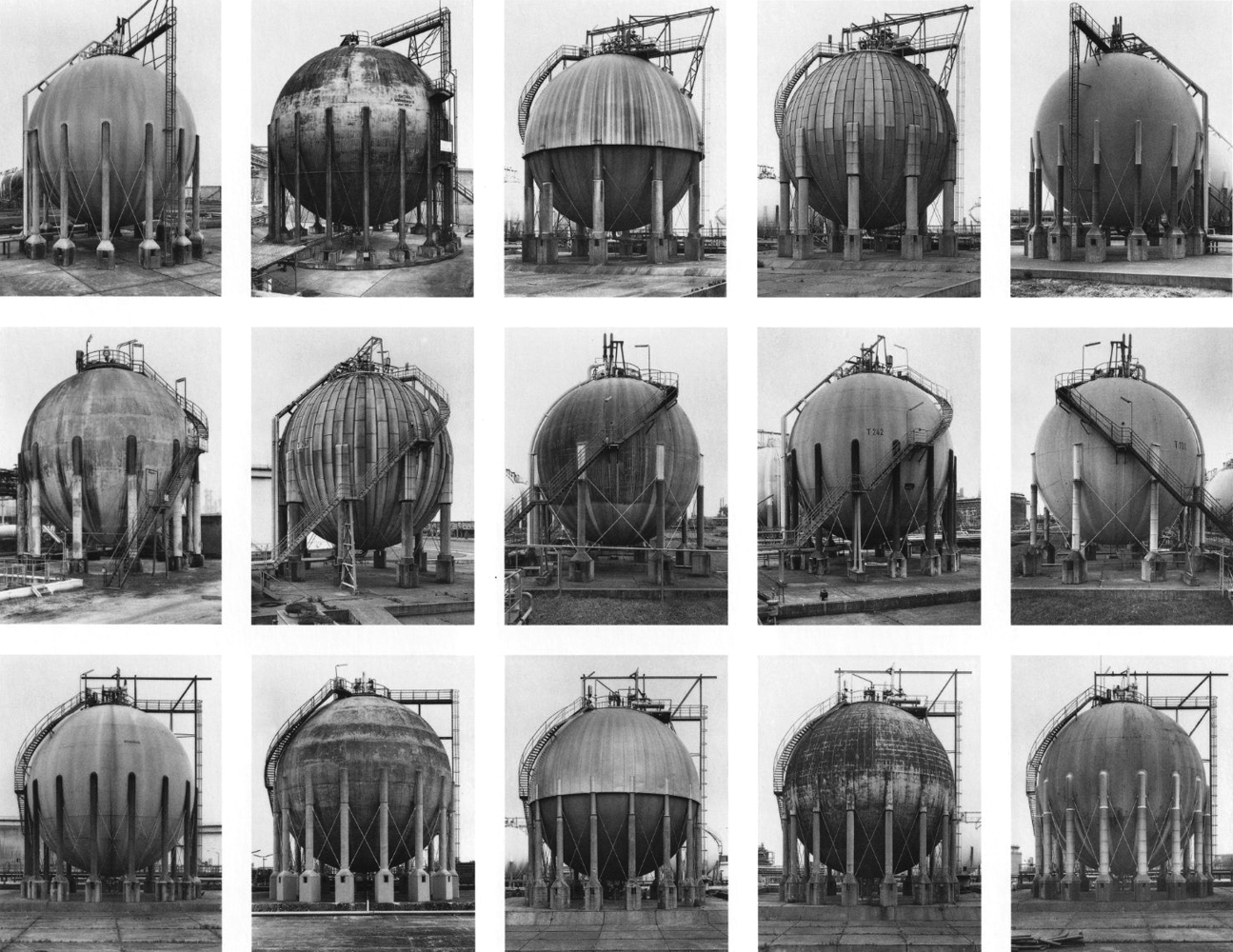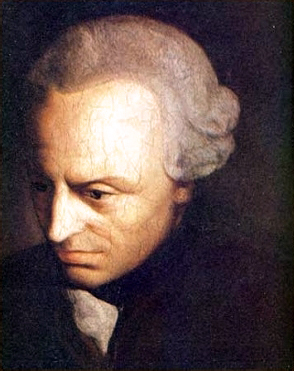J'ai voulu cet article comme l'expression d'une réaction (positive) de lecteur ; lors de la confrontation à l'article de Moritz Notenov consacré à l'univers poétique d'Alain Bashung, j'ai senti en moi s'opérer comme le comblement d'une lacune : celle de l'absence d'étude intelligente et approfondie sur l'œuvre même du chanteur, dans la surabondance d'ouvrages consacrés aux détails intimes et computables de sa vie d'homme (à laquelle j'avoue ne pas porter d'intérêt particulier). Les réflexions qui vont suivre s'inscrivent donc en écho à cette voix jetée dans l'abîme, et espèrent poursuivre d'un rien le mouvement amorcé par mon collaborateur – afin qu'il ne demeure pas, d'une certaine façon, lettre morte.
A propos de lettre, justement, étant maladivement porté sur le langage et ses manifestations, je ne m'occuperai dans cet essai d'essai (cette proposition, dirons-nous) que du texte lui-même, au sens de la partie linguistique de l'œuvre, et non, à mon grand regret, de sa partie musicale – par incompétence pure, le fait d'aborder une œuvre chantée dans sa seule dimension langagière étant à mon sens fortement dommageable. Plus précisément, je souhaiterais aborder l'écriture d'A.Bashung d'un point de vue stylistique, cherchant à dégager ce qui, au sein du message verbal qui l'occupe, s'écarte de l'usage traditionnel et familier de la langue, pour en faire une œuvre d'art à part entière. En d'autres termes, je chercherai à analyser la spécificité de sa prose, ce qui l'organise en une manière de signature.
Il y a, il me semble, chez Bashung, ce que j'aimerais appeler une tentation (une fascination ?) pour le double. Le langage, chez lui, n'est jamais saisi dans une quelconque unicité, une quelconque précision ; tout est toujours flou, glissant, redoublé - profondément ambivalent. L'écriture donne en permanence l'impression de se dérober, on croit l'avoir saisie mais déjà elle se rétracte, le sens sur lequel on croyait pouvoir s'appuyer cède sous la pression de la forme dans laquelle il s'insère. Le texte se déploie en définitive toujours dans plusieurs directions (ou plutôt dans plusieurs dimensions) simultanées, mais qui ne se donnent jamais à entendre simultanément. Autrement dit, l'auditeur est toujours maintenu dans une sorte d'incertitude quant à la compréhension du texte auquel il est confronté. Cette incertitude procède du fait qu'A.Bashung fait souvent coexister, au sein d'un énoncé unique, deux espaces de significations distincts, qui la plupart du temps entrent en conflit. Que de ce conflit naisse la dimension poétique (au sens restreint du terme) du texte de Bashung, c'est précisément ce que j'aimerais montrer ici. Pour cela, je m'intéresserai à deux manières spécifiques – deux figures(1) récurrentes dans son écriture, et qui permettent de provoquer cette situation de conflit. La première est celle du double tangible : le miroir ou l'écho, dont la présence jalonne le texte. Aucun terme, aucun syntagme n'existe chez Bashung de manière autonome, tous viennent s'inscrire dans un plus vaste réseau, phonique et sémantique, qui structure le texte, l'innerve, lui donne une cohérence, une couleur. Certaines chansons possèdent ainsi des « clés de lectures », des thèmes et parfois même des mots qui sont des sortes de dénominateur commun à l'ensemble du texte, des nœuds dont procède, découle l'ensemble des autres termes. La seconde figure, plus insaisissable, fonctionne davantage par surgissement(s) : c'est le double absent, fantomatique, le possible de la langue jamais complétement actualisé, mais dont on ne peut remettre en cause la présence souterraine. Cette figure, qui s'applique notamment de manière récurrente aux locutions, donne une véritable épaisseur au texte d'A.Bashung. En quelque sorte, si nous étions avec la première figure dans un rapport d'horizontalité du texte à son double, on entre ici dans un rapport de verticalité. Ce sont ces différentes modalités d'existence du texte que je vais désormais tenter d'analyser à l'aide de certains exemples.
 |
| Loup |
Concernant le premier type de figure (celle du miroir), je distinguerai différentes formes de sa présence au texte : la saturation (allitérations, paronomases(2)), la récurrence (notamment par le biais d'allophones(3)) et le renvoi direct (jeux de mots, calembours).
Je commencerai par traiter les échos qui, selon moi, sont les moins riches d'un point de vue poétique : les jeux de mots. En effet, les tensions qu'ils instaurent entre les mots sont davantage de l'ordre de l'amusement que de l'incongruité (nous sommes loin, la plupart du temps, des tables d'opérations et des rencontres qu'elles autorisent). Nous en citerons quelques uns des plus fameux, tels que « Guru, tu es mon führer de vivre » (Source : Guru), « tu m'as conquis j't'adore » (S.O.S Amor), « helvète underground » (Helvète Underground), ou encore « Robinson Crusoë n'a plus un vendredi libre » (id.). Au-delà des réflexions que peut engager ce dernier exemple sur la question de l'esclavage et sur le mythe du Bon sauvage, on admettra que l'on se situe plus du côté de la blague de potache que de la véritable trouvaille poétique. La plupart de ces jeux de mots ressortent davantage du calembour (jeu de mots fondés sur des mots se ressemblant par le son, différant par le sens), l'amorce étant d'ordre sonore – chanson oblige (à l'exception ici de l'exemple de Robinson, où le jeu de mot portant sur « vendredi » est davantage d'ordre diaphorique (reposant sur un second sens possible pour un terme utilisé – ici nom propre/nom commun)). On notera deux choses concernant cette propension au jeu de mot : la première est qu'elle peut déborder le cadre de la chanson pour s'étendre au cadre paratextuel de l'album : ainsi du live enregistrée lors de la tournée de l'album Novice : Tour Novice, ou de certains titres de chansons : Camping Jazz ... La seconde, d'ordre génétique, est que cette figure relativement peu productive d'un point de vue poétique semble caractériser une période précise de l'écriture d'A.Bashung : celle, plus précoce, durant laquelle il travaillait en collaboration avec le parolier Bergman. Cette relation textuelle me semble, je l'ai dit mais je m'en explique, assez pauvre du fait de son caractère particulièrement tranché : soit on comprend l'astuce, soit on ne la comprend pas ; soit l'on possède la référence, soit on ne la possède pas. Son ressort réside tout entier dans notre capacité de compréhension et notre vivacité d'esprit. Mais, une fois élucidé, le jeu de mots n'offre plus aucune difficulté ; il se donne tout entier ou ne se donne pas. Il ne possède pas cette propriété de résistance qui fonde, en mon sens, l'image poétique : une association dont la compréhension justement résiste, hésite ; une association qui ne se départit jamais totalement de son caractère d'(inquiétante) étrangeté, et pour laquelle demeure toujours une forme d'incertitude, de réticence. L'image poétique doit fuir l'évidence, et lui préférer, en quelque sorte, la rugosité. L'écho qui s'instaure entre les deux pôles du jeu de mots ne provoque jamais que, à mon sens, la satisfaction de l'esprit(4), et constitue en ce sens le « degré zéro » des figures que j'ai appelées du miroir, ou de l'écho.